xyx.
Parmi les insectes les papillons ou lépidoptères comptent parmi les groupes les plus évolués et les plus riches en espèces.
Phalène brumeuse


Phalène brumeuse , Cheimatobie hièmale [Operophtara brumata]
Caractères distinctifs : longueur de l'aile antérieure du ♂ : 1,1 à 1,4 cm ; ♀ microptère. La Phalène brumeuse fait partie de la famille des Géométrides — une des familles de Lépidoptères les plus importantes numériquement, puisqu'elle compte quelque 15 000 espèces au monde, dont plus d'un millier en Europe, arrivant immédiatement derrière les Pyrales (plus de 25 000 espèces au monde [10 000 Pyralides + 15 000 Crambides], dont près d'un millier en Europe). Dans le cadre de ces quelques fiches, il n’est possible de rassembler qu’une sélection des espèces les plus représentatives de la famille des Géométrides. La Phalène brumeuse illustre bien les caractéristiques de la plupart des espèces composant cette famille : corps frêle, ailes molles et fragiles, larges et arrondies, disposées à plat et plus ou moins entrouvertes en position de repos, de sorte que les ailes postérieures ne sont jamais complètement cachées par les antérieures, En cela, les Phalènes se distinguent très nettement des Noctuelles, dont les ailes antérieures, refermées en toit, dissimulent toujours en posture de repos les ailes postérieures repliées en éventail.
La Phalène brumeuse présente un type d'ornementation caractéristique d'un bon nombre de Géomètres : ailes antérieures unicolores, brun grisâtre à brun jaunâtre foncé, traversées par plusieurs lignes transversales foncées et denticulées ; ailes postérieures gris blanchâtre uniforme, sans dessins. En revanche, cette espèce singularise par le microptérisme de sa 9 : les ailes de celle-ci sont réduites à de minuscules moignons. Inapte au vol, la ♀ de la Phalène brumeuse se réduit pour ainsi dire à une « machine à pondre » : après l'émergence, elle demeure à proximité de la dépouille nymphale, émettant sa phéromone sexuelle et attendant qu'un c1' vienne la féconder. Immédiatement après l'accouplement, elle dépose ses œufs, puis meurt quelques heures plus tard.
D'autres espèces de Géomètres (appartenant à diverses sous-familles) se singularisent par l'atrophie des ailes pour les ♂.
Habitat : les Phalènes sont dans leur immense majorité des Insectes sylvatiques. Toutefois, bon nombre d'entre elles habitent également les milieux découverts à vocation agricole, les berges broussailleuses des ruisseaux et les vallées aux biotopes variés. La Phalène brumeuse vole dans les jardins, les forêts d'essences feuillues mélangées, les vergers et les parcs urbains.
Répartition : les Phalènes sont répandues à travers toute l'Europe et s'étendent au nord jusqu'à la limite des terres polaires. En raison de leur constitution fragile et délicate, elles sont souvent emportées par les courants aériens, parfois à des distances considérables de leur habitat d'origine. Si ce transport passif peut parfois contribuer à étendre l'aire de répartition de certaines espèces, il mène toutefois le plus souvent ces Insectes à la mort : ainsi, par exemple, les espèces insulaires sont projetées dans les flots des océans, tandis que certaines espèces montagnardes sont entraînées dans l'étage nival, où les conditions de leur survie ne sont plus assurées.
La Phalène brumeuse est avant tout répandue dans l'ouest, le nord et le centre de l'Europe. A l'est, elle s'étend jusqu'à l'Amour.
Fréquence : la Phalène brumeuse compte parmi les Géomètres européennes les plus banales.
Époque du vol : de la mi-octobre à la fin décembre. L'espèce ne sort qu'après les premiers froids.
Phénologie de la chenille : mai-juin. L'œuf hiverne. Comme la plupart des chenilles de Géomètres, celles de la Phalène brumeuse ne possèdent que deux paires de fausses-pattes abdominales, ce qui détermine leur curieux mode de reptation: en progressant, la chenille fait le « gros dos » et semble mesurer le terrain, d'où les noms d'Arpenteuses et de Géomètres qui leur sont communément attribués.
Plantes nourricières : feuillus (arbres fruitiers et forestiers) ; Lichens. Les jeunes chenilles dévorent les bourgeons et les jeunes pousses; plus âgées, elles s'attaquent au feuillage
Intruse

Intruse [Archiearis parthenias]
Caractères distinctifs : longueur de l'aile antérieure : 1,5 à 2 cm. Contrairement aux autres Géomètres, celles du genre Archiearis ressemblent par leur forme et leur ornementation à de petites Noctuelles ; toutefois, certains caractères (nervation, notamment) indiquent clairement qu'il s'agit de vraies Phalènes. L'Intruse présente des ailes antérieures brunes à brun rougeâtre, saupoudrées d'atomes gris blanchâtre. Chez certains individus, les marbrures blanches peuvent faire défaut ; la couleur des ailes antérieures, beaucoup plus unie, ressemble alors à s'y méprendre à celle d'A. notha. Ailes postérieures jaune orangé avec des dessins brun sombre d'étendue variable, notamment une grande plage anale, une tache discoïdale, et une bande marginale irrégulière. Le d de l'Intruse porte des antennes simplement ciliées (elles sont bipectinées chez le d d'A. notha).
Habitat : tourbières hautes abritant des Bouleaux, trouées, clairières et bois clairs de résineux installés sur sol sablonneux.
Répartition : L'Intruse est largement répandue à travers toute l'Europe, mais sa distribution est plus ou moins morcelée par suite de soi inféodation au Bouleau. Mieux représenté dans le nord que dans le sud de l'Europe. Dans les massifs montagneux, s'élève jusqu'à I. limite supérieure de la forêt.
Fréquence : très commune dans les tourbière hautes abritant des Bouleaux et leurs abords ; rare dans le sud de l'Europe.
Époque du vol : début mars à fin avril. L'Intrus compte parmi les premiers Papillons à se montrer au début de l'année. Elle vole en plan jour et se pose volontiers sur le sol, ailes entrouvertes, pour se chauffer au soleil, ou pour se désaltérer au bord des flaques d'eau. Lorsqu'il gèle, il suffit de « battre » l’arbres, le matin, avant la disparition du givre pour en faire tomber ce Papillon, complètement roide et paralysé par le froid.
Phénologie de la chenille : de mai à juillet. Contrairement aux autres chenilles de Géomètres, celle de l'Intruse possède quatre paires de fausses-pattes abdominales.
Plantes nourricières : Bouleaux.
Archiearis notha

Archiearis notha
Caractères distinctifs : longueur de l'aile antérieure : 1,4 à 1,8 cm. Ressemble beaucoup à l'Intruse, mais s'en distingue par l'aspect bien moins contrasté de ses ailes antérieures (encore que chez l'Intruse, certains sujets présentent aussi parfois des ailes antérieures d'une teinte assez uniforme). Le seul dessin clair vraiment net est la ligne submarginale ; la ligne post-médiane, foncée, est parfois faiblement soulignée de blanchâtre. Le bord costal présente une courte strie blanchâtre entre les lignes post-médiane et submarginale. La ligne antémédiane est bordée du côté basal par une assez large bande brun sombre. Ornementation des ailes postérieures comme chez A. parthenias. Le d d'A. notha porte des antennes nettement bipectinées, ce qui le distingue de celui de parthenias, dont les antennes sont simplement ciliées.
Habitat : A. notha vole aussi dans les tourbières hautes à Bouleaux, mais n'y est pas aussi strictement inféodé que l'Intruse. Il fréquente également les peupleraies, les bois clairs hébergeant des Trembles, les lisières, les landes et les bords des lacs, à condition d’y trouver des Saules et des Peuplier
Répartition : Europe froide et tempérée ; distribution morcelée, particulièrement dans sud de l'Europe, où A. notha manque dans maintes régions.
Fréquence : espèce commune par endroit mais se présentant la plupart du temps par individus isolés ; rare dans le sud de l'Europe
Époque du vol : de début mars à la fin d'avril durant les premières belles journées de l'année. Activité diurne. Le Papillon frequente volontiers les chatons en fleurs des Saule. Lorsque le printemps est froid et humide, période de vol de cette Phalène est considérablement écourtée.
Phénologie de la chenille : mai à juillet.
Plantes nourricières : Tremble (Populus trimula), Saule Marsault (Salix caprea) et Bouleaux
Zérène du Groseillier
 x
x 
Zérène du Groseillier, la Phalène mouchetée [Abraxas grossulariata]
Caractères distinctifs : longueur de l'aile antérieure : jusqu'à 2 cm. Grande espèce, bien caractérisée par son ornementation aux teintes criardes. Ailes antérieures à fond blanc, rehaussées de six lignes transversales plus ou moins complètes de gros points noirs, avec deux bandes jaune orangé dans les aires basilaire et postmédiane. Thorax et abdomen jaune orangé, portant une seule rangée dorsale de points noirs. Ailes postérieures blanches avec deux lignes de points noirs, l'une postmédiane, l'autre marginale, et un point discoïdal noir. La taille des points noirs et l'extension des aires jaune orangé varient dans des proportions considérables. Chez certaines formes, le jaune est plus ou moins largement étendu, tandis que les bandes noires sont obsolètes, voire évanescentes ; dans d'autres formes, les aires jaunes sont très restreintes, ou bien font défaut, tandis que le noir prédomine.
Habitat : forêts périodiquement inondées, bords des ruisseaux broussailleux, jardins complantés, d'arbustes à baies.
Répartition : largement répandue à travers toute l'Europe ; plus dispersée dans le nord où elle atteint toutefois le sud de la Scandinavie.
Fréquence : très variable d'une année sur l'autre. Certaines années, l'espèce est si abondante qu'elle cause de graves dégâts dans le cultures de Groseilliers et de Cassissiers.
Époque du vol : de la mi-juin à la fin août. Activité nocturne.
Phénologie de la chenille : août à juin, avec hivernage. La chenille présente les mêmes couleurs aposématiques (blanc, noir et jaune orangé) que l'adulte. Elle se nourrit la nuit.
Plantes nourricières : Groseillier, Cassissier.
Zérène de l'Orme

Zérène de l'Orme [Abraxas sylvata]
Caractères distinctifs : longueur de l'aile antérieure : 1,5-1,8 cm. Proche parente de la Zérène du Groseillier, la Zérène de l'Orme s'en distingue par sa taille un peu plus faible et son ornementation, plus restreinte, plus pâle et bien moins contrastée. Les lignes caractéristiques de grossulariata n'existent plus ici qu'a l'état de vestiges ; le noir est remplacé par du gris bleuâtre plombé, et le jaune orangé par du brun fauve. Se détachent plus nettement une grande tache discoïdale ronde, ardoisée, aux ailes antérieures, et trois grandes macules 'sombres, mêlées de gris noirâtre, de bleuâtre et de rouille, les deux premières dans les aires basilaire et tornale de l'aile antérieure, la troisième à l'angle anal des ailes postérieures. Thorax et abdomen brun jaunâtre, rehaussés de nombreux petits points noirs. Bien que la Zérène de l'Orme présente également un gradient de variation très accentué, elle reste toujours très facile à distinguer de la Zérène du Groseillier.
Habitat : forêts périodiquement inondées, bois de feuillus humides, grands parcs abondamment envahis par les broussailles, gorges et vallées broussailleuses.
Répartition : en Europe, à travers toute la zone des forêts de feuillus.
Fréquence : pas rare dans les forêts inondables ; parfois abondante.
Époque du vol : fin mai à début août. Activité nocturne ; vol mou et nonchalant. Au repos dans le feuillage, le Papillon ressemble à une fiente d'Oiseau.
Phénologie de la chenille : juillet à septembre. La chenille porte une robe violemment contrastée, comme celle de la Zérène du Groseillier, mais se distingue de celle-ci par son ornementation à base de lignes longitudinale (et non de points). La nymphose a lieu au niveau du sol, dans un cocon lâche. La chrysalide hiverne.
Plantes nourricières : Cerisier à grappes. Ormes, Hêtres ; également sur les Coudriers. les Bouleaux et les Cerisiers, mais plus rarement.
xyx
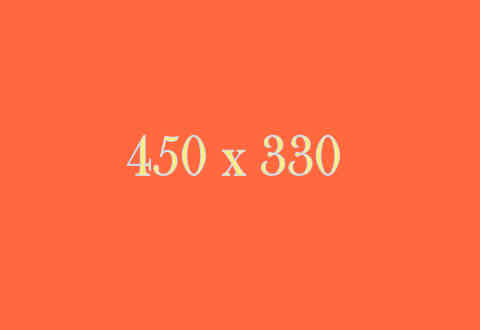
xyx
