Roman d'analyse, publié en 1678, sans nom d'auteur, par Mme de La Fayette (1634-1693).
Fille d'un gouverneur du jeune marquis de Brézé, Mme de La Fayette ne portait à son mari, gentilhomme auvergnat de vieille souche, qu'une affection raisonnable. Elle avait compté parmi les « Précieuses », et se fixa définitivement à Paris où, comme l'écrit Mlle de Scudéry, elle devint, à l'âge de trente-deux ans, la « favorite » et la « meilleure amie » du quinquagénaire La Rochefoucauld. Romanesque, rêveuse, froide (on l'avait surnommée « le Brouillard »), avec beaucoup de discrétion et de pudeur, elle était surtout, au dire de Mme de Sévigné, « très vraie et très franche ; il fallait la croire sur parole ». Dame « de bel air », mais aussi des plus cultivées, elle était accueillante aux gens de savoir tels que Huet, Ménage, — qui l'avait aidée à situer l'action de son premier écrit : la Princesse de Montpensier — Segrais, qui donna ses conseils pour la Princesse de Clèves. Ce roman, non officiellement avoué, d'une grande dame, avec la collaboration d'un duc et pair, avait été élaboré dès 1672, mais c'est seulement au cours de l'hiver 1677 que Mme de La Fayette s'y consacra décidément, de concert avec La Rochefoucauld. Elle habite alors un bel hôtel avec Jardin, sis au coin des rues de Vaugirard et Férou, et, tous les jours, le duc désenchanté, lui aussi paroissien de Saint-Sulpice, — il est déjà, à cette époque, l'auteur des Réflexions ou sentences et maximes morales, — la vient rejoindre dans le cabinet vert où l'attend un petit bureau muni de son écritoire « en façon de la Chine ».
Une jeune fille sévèrement élevée par sa mère. Mlle de Chartres, l'une des plus grandes héritières du royaume, épouse sans l'aimer, mais avec le ferme dessein de lui être fidèle, un homme qu'elle estime : le prince de Clèves qui, dès le premier abord, avait conçu pour elle un amour extraordinaire. Peu de temps après ce mariage de raison, elle rencontre, au cours d'un bal donné par la reine, un jeune gentilhomme entre tous séduisant. M. de Nemours. Il s'éprend d'elle et le lui laisse entendre, sans oser toutefois déclarer ouvertement sa passion. La jeune femme éprouve alors un émoi qu'elle n'avait pas encore ressenti. Elle sait bien que « les paroles les plus obscures d'un homme qui plaît donnent plus d'agitation nue des déclarations ouvertes d'un homme qui ne plaît pas » et de nouvelles rencontres vont encore augmenter son trouble. Peu après, sa mère meurt, non sans lui avoir dit, clairvoyante : « Vous êtes sur le bord du précipice ; il faut de grands efforts et de grandes violences pour vous retenir»
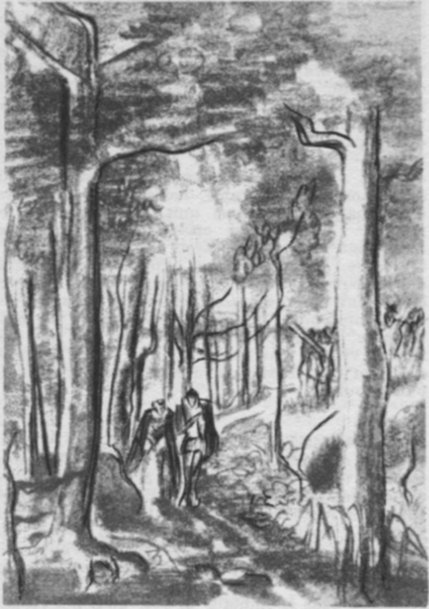
Placez ici le contenu de class "colleft"
Tremblante devant l'amour, mais soucieuse d'être fidèle et, comme on disait alors, de préserver sa « gloire» Mme de Clèves décide brusquement de se mettre sous la protection de son mari : elle lui avoue son amour naissant, ne cache pas sa crainte de demeurer « exposée au milieu de la Cour » et le supplie en ces termes : « Conduisez-moi, ayez pitié de moi, et aimez-moi encore si vous pouvez». Finalement, M. de Clèves, fort touché mais au désespoir, lui permet de se retirer dans un petit pavillon à Coulommiers. Elle ne tarde pas, cependant, à regretter cet aveu : son mari, jaloux de Nemours, est devenu « le plus malheureux de tous les hommes » et, désormais, le moindre incident peut nourrir son inquiétude. Or, une amie de la princesse ayant conté innocemment que Mme de Clèves trouvait plaisir à se promener toute seule, la nuit, dans la forêt. Nemours, soudain, songe à se rendre à Coulommiers afin de voir sans être vu. M. de Clèves, de son côté, devinant sa pensée, ne doute pas que le jeune homme ait l'intention de voir sa femme. Nemours part donc, bientôt suivi d'un gentilhomme que le prince a envoyé sur ses pas. Il pénètre dans le jardin, puis, s'approchant du logis, observe son insu Mme de Clèves, « toute occupée de choses qui avaient du rapport avec lui et la passion qu'elle lui cachait ». M. de Clèves, cependant, trompé par de faux récits, est convaincu que Nemours a vu sa femme en secret. Alors, pressentant sa fin prochaine, il fait venir la princesse, lui reproche son infidélité et, lorsque finalement elle le détrompe ; c'est trop tard : il meurt.
Libre enfin de suivre son inclination sans manquer â l'honneur, Mme de Clèves, que Nemours presse de l'épouser, lui avoue à la fois son amour et la résolution qu'elle a prise de rester veuve, car elle ne veut pas du bonheur au prix de la mort d'un époux. La jeune femme, renouant au monde, s'ensevelit dans une retraite lointaine. Atteinte d'une maladie de langueur, elle succombera, victime de sa fidélité.
« On est partagé sur ce livre-là à se manger ! », écrit Mme de La Fayette après la parution de la Princesse de Clèves, et certes, ce roman de deux cents pages contraste fort avec les fictions de Gomberville ou de Mlle de Scudéry. Les personnages en sont français, et non plus grecs ou romains ; l'air qu'ils respirent, c'est celui de la cour de France, voluptueuse et raffinée, dans les dernières années du règne de Henri II. Mais c'est surtout, â travers la chronique d'une société de princes et de princesses, — « parfaites personnes » éprises de grandeur, — l'étude précise, nuancée et combien décente, de passions que dénonce seulement un silence ou la pâleur d'un visage. Héroïne de haute exigence, Mme de Clèves nous toucherait moins si elle n'était très humaine. Elle avait le choix entre Racine et Corneille, entre le bonheur et le sacrifice : et c'est le sacrifice qui aura le dernier mot. Le public, toutefois, jugea la « scène de l'aveu » singulièrement audacieuse et si Fontenelle, enthousiasmé, lut quatre fois la Princesse de Clèves, Mme de Sévigné et Bussy-Rabutin ont parlé d'« extravagance » et d'« invraisemblance ». Bientôt parurent, sous la signature de J.H. de Valincour, les Lettres à Mme la marquise de X… sur le sujet de la Princesse de Clèves, critique pénétrante du style, de la conduite des événements et des sentiments prêtés aux personnages. «J'y ai trouvé mille difficultés », écrit-il, et le jeune lettré d'ajouter que l'on trouverait « une histoire qui a quelque rapport avec celle-ci » dans les Désordres de l'amour, roman de Mme de Villedieu. Mme de Clèves, observe cet ami de Boileau, est extrêmement belle, avec des cheveux blonds, mais on ne nous dit pas si elle avait de l'esprit… Serait-elle niaise comme l'Agnès de l'École des femmes ? « L'aveu qu'elle fait à son mari de l'amour qu'elle a pour un autre homme » justifie, lui semble-t-il, la comparaison, et l'on eût pu lui donner « un peu plus d'esprit qu'elle n'en a et même sans craindre de lui en donner trop… ». Un certain abbé de Charnes, qui se disait documenté de bonne part, riposta en publiant sous l'anonymat une Conversation sur la critique de La Princesse de Clèves (mai 1679), dans laquelle il assurait que la scène de l'aveu avait été empruntée au Polyeucte de Corneille bien avant que Mme de Villedieu eût publié son roman. Trop de digressions, trop d'effets concertés, écrivait encore Valincour… et M. de Clèves ne prend-il pas bien vite le parti de mourir ?… Mais c'est à l'« aveu » que, toujours, on revenait. Dès avril 1678, Donneau de Visé, directeur-fondateur du « Mercure galant ouvrit à ce propos une enquête dans les provinces ; les réponses furent sévères pour Mme de Clèves : « Pareil aveu, répondait l'un, ne sortit jamais de lèvres féminines dans mon rustique pays. Quelle de nos bergères s'aviserait d'imiter cette princesse dénuée d'esprit ? » ; « Plutôt éternellement combattre, disait l'autre (c'était une femme) et mourir dans les combats». Un troisième, enfin, constatait qu'« un homme est plus heureux d'être trahi sans le savoir que d'être le confident d'une femme qui le hait le plus vertueusement du monde ». Telles sont, en dépit d'une admiration très grande, les réserves que se permettaient les contemporains. Figée dans sa gloire, la Princesse de Clèves a moins à craindre aujourd'hui, de certaines objections sincères que de l'hommage obligé des manuels. Cette princesse sacrifiée, note par exemple l’écrivain Armand Hoog (1912-1999), « ce n'est donc pas à la vertu qu'on la sacrifie, c'est à une image très particulière de l'âme humaine, où les ténèbres impitoyablement refoulées n'ont pas droit de cité ». Moderne est, cependant, la Princesse de Clèves, et non pas seulement dans l'hommage isolé que M. de Nemours rend à la nature, lorsqu'il s'en va « sous les saules, le long d'un petit ruisseau » Max Jacob se moque de cette dame « qui parle en style oraison funèbre à sa femme de chambre, rougit devant l'homme qu'elle aime et refuse pendant 22 pages de lui parler » ; mais il en est aussi pour établir quelque parenté entre la princesse sacrifiée et l'Alissa de la Porte étroite. On sait, par ailleurs que, Raymond Radiguet, lorsqu'il écrivit le Bal du comte d'Orgel, rêvait d'imiter sa devancière du XVIIe siècle.
Roman du mariage, du déchirement, de l'immolation, ce petit livre (où nous voyons un mari malheureux qui n'est pas ridicule) demeure une œuvre vivante. La scène de l'aveu, tant discutée, n'a pas trouvé de commentateur plus compréhensif que Marcel Arland lorsqu'il écrit : « Rien, d'ailleurs, de mieux amené que cet aveu ; nous y sommes préparés, nous l'attendons ; et c'est le hasard qui soudain le fait naître, l'inquiétude et les pressantes questions du mari, l'embarras et le silence de la femme, — et voilà que ce silence a trop duré, qu'elle ne sait comment en sortir et qu'elle cède à son impulsion» (« Eh bien, monsieur, lui répondit-elle en se jetant à ses genoux, je vais vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à un mari … »). A peine l'a-t-elle fait, elle trouvait qu'elle s'y était engagée sans en avoir presque eu le dessein ». Et le même écrivain de conclure : « Il me semble que Mme de La Fayette a créé dans le roman la langue de la passion, et jusqu'à ses pudiques ou impurs silences »
